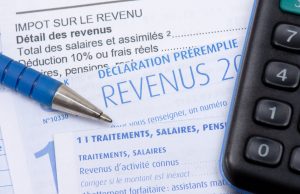Un plan pour éliminer l’usage des téléphones en prison
Depuis plusieurs mois, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaite lutter contre l’utilisation des téléphones mobiles en prison. Selon lui, leur usage par les détenus est « totalement inacceptable pour les victimes et pour l’ensemble de la société ».
Gérald Darmanin veut faire disparaître ces appareils dans les établissements pénitentiaires. Lors d’une visite au centre pénitentiaire de Paris-La-Santé, il a présenté son « plan zéro portable ». Depuis sa prise de fonction en décembre 2024, le ministre a rapidement placé ce problème parmi ses priorités.
Il a d’ailleurs indiqué que 80 000 appareils avaient été saisis l’an dernier. Il a aussi expliqué comment il envisageait de réduire encore davantage l’utilisation des téléphones en cellule.
Mesures pour renforcer la sécurité et limiter l’usage des téléphones
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions concrètes sont prévues. Tout d’abord, une dizaine d’établissements va bénéficier de travaux de sécurisation, pour un budget de 29 millions d’euros. Ces travaux, qui dureront environ 6 à 7 mois, concernent notamment les prisons de La Santé, Dijon, Arras, Toulouse-Seysses, Toulon et Rennes-Vezin. L’objectif est d’améliorer la gestion de 5 500 détenus.
Par ailleurs, le ministère prévoit de renforcer la surveillance des survols de drones. Ces appareils sont souvent utilisés pour livrer des objets aux détenus. En 2025, quelque 5 000 survols ont été recensés. Déjà équipées dans 58 prisons, des dispositifs anti-drones seront déployés dans 19 autres centres d’ici la fin du premier trimestre 2026. Des fenêtres seront également renforcées avec des caillebotis pour empêcher la transmission d’objets.
Le recours au brouillage des connexions mobiles est aussi envisagé. Quatorze prisons disposent déjà de cette technologie, et le ministre souhaite accélérer leur déploiement avec l’installation de nouveaux brouilleurs.
Technologies et réformes pour un changement en profondeur
Des portiques à ondes millimétriques, capables de détecter la présence d’objets illicites, sont déjà en place dans cinq prisons. Leur installation dans d’autres établissements est prévue, avec un budget de 1,7 million d’euros.
Gérald Darmanin veut aller plus loin dans la réforme du système carcéral français. Il souhaite notamment revoir la sociologie des détenus en privilégiant la séparation selon leur dangerosité. Inspirée de la loi antimafia italienne, cette approche vise à classer les prisonniers en fonction de leur profil et à les placer dans des établissements adaptés.
Selon lui, cette méthode permettrait de concentrer les moyens de sécurité et de lutte contre la récidive, notamment en distinguant cinq catégories de détenus. Certains établissements seraient ainsi équipés de dispositifs de sécurité renforcée, comme cela a été le cas après l’affaire Amra.
Le ministre a également évoqué l’affaire Salah Abdeslam, qui aurait utilisé un ordinateur portable et des clés USB depuis sa cellule, malgré une surveillance renforcée. Il insiste sur la nécessité de lutter contre ces pratiques, souvent considérées comme naïves ou dépassées.
Il dénonce aussi la tolérance envers la consommation de drogues en prison, notamment le cannabis, qui selon lui, est largement répandue. Il considère que la société ne peut pas accepter que des détenus puissent téléphoner ou consommer de la drogue en prison, ce qui est inacceptable pour les victimes et la société tout entière.
Une réponse adaptée à la situation à Marseille
Pour améliorer la sécurité, le ministre propose un « travail de fermeté » et un accompagnement accru des agents pénitentiaires. Il souhaite aussi mettre en place un nouveau régime, inspiré de la loi anti-mafia italienne. Ce système classerait les détenus selon leur dangerosité, et non plus seulement selon leur statut juridique.
Ce classement permettrait de répartir les détenus dans des établissements différents, selon leur profil. Gérald Darmanin explique que cette approche, adoptée notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, permettrait de concentrer les ressources là où elles sont le plus nécessaires.
Il cite en exemple la situation à Marseille, où la mise en place d’établissements de haute sécurité a été efficace. Le 13 novembre dernier, un frère d’un militant anti-narcotrafic a été assassiné dans la rue. La région a connu plusieurs violences liées au crime organisé, ce qui justifie cette stratégie renforcée.